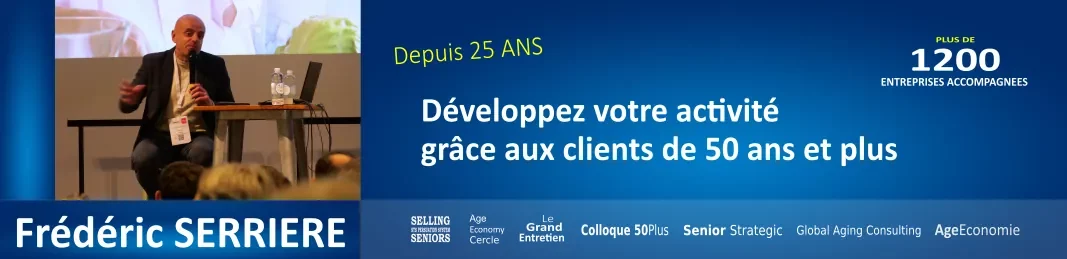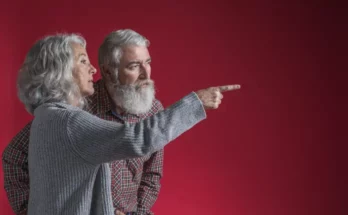Depuis des années, j’accompagne des entreprises, collectivités et mutuelles dans la conception et l’amélioration de leurs actions de prévention.
L’objectif est clair : permettre à davantage de personnes d’adopter des comportements de prévention, en particulier celles qui en sont les plus éloignées — souvent celles qui auront, plus tard, le plus de difficultés à vieillir en bonne santé.
Pourtant, sur le terrain, un schéma se répète inlassablement.
Les participants aux actions de prévention appartiennent à deux catégories :
- Les convaincus, déjà sensibilisés à la santé et à la prévention.
- Les réactifs, qui s’inscrivent après un incident ou une alerte médicale.
Entre les deux, une immense majorité reste à distance.
Ces personnes refusent, repoussent ou minimisent la prévention.
Les raisons ? Variées : déni, procrastination, méconnaissance, mais aussi valeurs culturelles — notamment l’idée que “prendre soin de soi, c’est admettre sa faiblesse”.
Le mythe du message rationnel
Les politiques publiques et les acteurs de la prévention ont longtemps misé sur l’information et la pédagogie.
Mais ce modèle ne suffit plus.
On ne change pas les comportements par la seule raison.
Les neurosciences le rappellent : la motivation durable repose sur le plaisir, la gratification, le lien social — jamais sur la contrainte.
Les campagnes bien intentionnées, les ateliers instructifs, les conférences “bonnes pour la santé” restent souvent confinés à ceux déjà convaincus.
Le reste de la population décroche.
Ce que les salles de sport nous apprennent
Chaque mois de septembre, les salles de sport se remplissent.
Et chaque fin octobre, elles se vident.
Les adhérents s’inscrivent pleins d’enthousiasme : perte de poids, tonification, transformation physique.
Mais les résultats tardent, la motivation s’épuise.
En quelques semaines, plus de 60 % disparaissent… sans même résilier leur abonnement.
Pourquoi certains continuent malgré tout ?
Parce qu’ils viennent pour autre chose : la convivialité, le lien, la routine agréable.
Leur bénéfice secondaire — se sentir bien entouré — est devenu leur bénéfice principal.
Et c’est précisément ce mécanisme qu’il faut transposer à la prévention.
Le pouvoir du bénéfice secondaire
Aujourd’hui, les actions de prévention s’appuient presque toujours sur un bénéfice principal rationnel : “préserver votre santé”, “éviter les maladies”, “vivre plus longtemps”.
Mais ces arguments peinent à toucher émotionnellement ceux qui ne se sentent pas concernés.
La clé serait d’inverser la logique :
- placer le plaisir, la socialisation ou la curiosité comme bénéfice principal,
- et faire de la prévention un bénéfice secondaire, naturel, presque invisible.
Un atelier mémoire assorti d’un buffet.
Une activité de groupe conviviale où la santé devient une conséquence, pas le prétexte.
Une application mobile ludique qui incite à bouger, sans jamais parler d’exercice physique.
Inverser le moteur : du devoir au plaisir
Cette inversion n’est pas qu’une idée marketing : c’est une stratégie d’impact.
Plutôt que de tenter de “vendre la prévention”, on la glisse dans une expérience valorisante.
Et soudain, elle attire aussi ceux qui, jusque-là, s’en détournaient.
Prenons un exemple concret.
À La Réunion, j’accompagne un projet centré sur… les LEGO.
Rien à voir, en apparence, avec la santé.
Pourtant, ces ateliers stimulent la motricité fine, la cognition, le lien social, et l’estime de soi.
Les participants viennent pour construire, créer, échanger.
Ils repartent en ayant fait de la prévention — sans même l’avoir décidé.
Le bénéfice principal est ludique et social.
La prévention devient un effet collatéral positif.
Vers un nouveau modèle d’actions de prévention
Ce renversement ne remplace pas les approches existantes :
- Les actions pour les convaincus doivent continuer, car elles renforcent les comportements acquis.
- Les actions pour les réactifs restent essentielles, car elles préviennent les rechutes.
- Mais un troisième type d’action doit émerger : celles destinées aux “non-convaincus”, où la prévention n’est plus le message central, mais le bénéfice secondaire.
Des ateliers cuisine où le plaisir de cuisiner prime sur la nutrition.
Des groupes de marche dont la première promesse est la convivialité.
Des clubs d’activités artistiques qui, sans le dire, améliorent la santé mentale et physique.
L’enjeu stratégique : créer des portes d’entrée désirables
La prévention ne changera d’échelle que lorsqu’elle cessera d’être perçue comme un devoir.
Il faut des portes d’entrée désirables, des bénéfices immédiats, des expériences qui valorisent.
Autrement dit : passer de la logique “il faut” à la logique “j’ai envie”.
Et c’est dans ce glissement, subtil mais décisif, que se joue l’avenir de la prévention.
Et si, finalement, la prévention cessait d’être une cause à défendre…
pour redevenir une conséquence heureuse ?
Formation 2026 : Maximiser l’Efficacité de ses Actions de Prévention pour les Seniors (60+)
Les initiatives de prévention dédiées aux jeunes retraités se multiplient, mais le faible taux de participation interroge.
Et de plus en plus d’organisateurs questionnent la pertinence du ciblage actuel.
Cette formation apporte des solutions concrètes issues du marketing des seniors, de la psychologie sociale et de la psychologie comportementale, pour aider les acteurs de la prévention à rendre leurs dispositifs plus attractifs et plus efficaces.
Ce que vous apprendrez
- Comprendre les profils cohérents : identifier les seniors réellement réceptifs à la prévention.
- Optimiser l’architecture des ateliers : structurer vos actions autour des motivations profondes.
- Communiquer efficacement : susciter l’intérêt sans heurter les valeurs ni la liberté perçue.
Objectifs
- Rendre vos actions plus efficaces auprès des 60+
- Augmenter le nombre de participants
- Cibler les profils cohérents avec vos objectifs
- Adapter votre communication à chaque culture de prévention
Public concerné
Directeurs autonomie, responsables prévention, mutuelles, collectivités, assureurs, acteurs de la Silver Économie, directeurs marketing, chefs de produit, responsables innovation, etc.
Formateur
Frédéric Serrière – consultant-pionnier du marché des seniors depuis 1998.
Fondateur d’Age Economy, GlobalAgingConsulting, et producteur de l’émission Le Grand Entretien.
En savoir plus
- Nous contacter via le formulaire
- Télécharger la plaquette de la formation
NEWSLETTER
Recevez chaque semaine la newsletter AgeEconomie et l'émission Le Grand Entretien
EMISSION LE GRAND ENTRETIEN
Le site de l'émission (vidéos et replays)